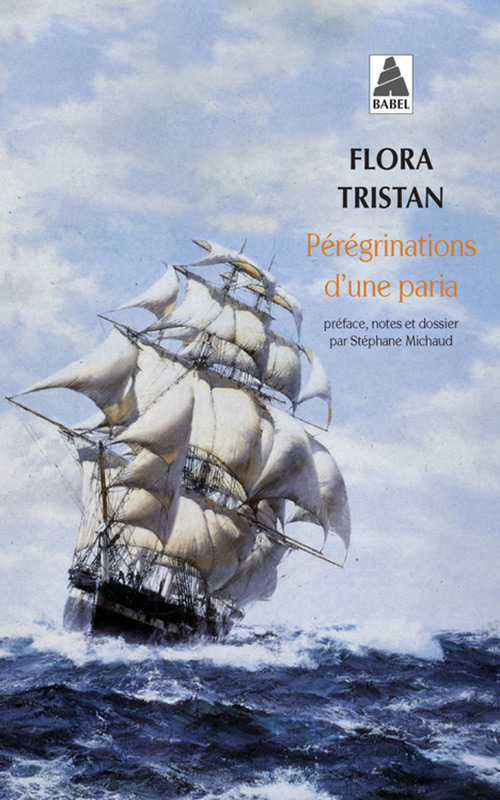
Pérégrinations d’une Paria fait partie de ces livres inclassables : récit de voyage, chronique du Pérou, essai politique, mémoires autobiographiques… c’est tout cela mais c’est aussi une bombe littéraire, provocatrice, radicale qui créa un immense scandale de Paris jusqu’ à Lima. Ce n’est pas une exagération : le livre fut brûlé en place publique à Arequipa et valut à l’autrice une tentative d’assassinat par son mari.
Cet ouvrage incendiaire est signé Flora Tristan. Paru en 1838, il relate le téméraire voyage qu’elle fit au Pérou entre 1833 et 1834 sur les traces de son richissime oncle. L’écrivaine franco-péruvienne a alors 30 ans. Orpheline de père à 4 ans, mariée à 17 à un homme violent, mère de deux enfants, n’ayant reçu ni éducation ni fortune, Flora Tristan se débat à Paris pour vivre digne et libre. La condition des femmes est alors terrible : le code civil interdit le divorce ; l’homme a tous les droits sur sa femme et ses enfants ; Flora Tristan a quitté son époux depuis près de six ans mais reste prisonnière de ce mariage. De plus, les enfants “naturels” n’ont aucun droit. C’est le cas de Flora Tristan, qui porte le nom de son père, mais n’est pas considérée comme une enfant légitime, le mariage de ses parents n’ayant pas été célébré régulièrement. Elle est donc, infamie supplémentaire, une bâtarde.
C’est la raison pour laquelle elle s’affuble du surnom de Paria, à l’image des “intouchables” mis au ban de la société indienne. Mais Flora Tristan n’est pas de son époque et refuse son destin d’opprimée. Elle décide donc de partir au Pérou, laissant derrière-elle ses enfants, pour tenter d’obtenir une part de l’héritage paternel aux mains de son oncle, seul à même de lui offrir l’indépendance et la sécurité auxquelles elle aspire. Grâce à une aide octroyée par cet oncle, elle embarque sur un bateau à vapeur pour un périple de près de six mois qui la mènera jusqu’au Pérou.
Les Pérégrinations sont donc d’abord un récit de voyage: c’est même le tout premier rédigé par une femme, à une époque où il était rarissime sinon scandaleux pour une dame de voyager seule. Avec un style lyrique propre à l’époque romantique, elle nous narre son extraordinaire aventure : de Bordeaux, le navire fait escale au Cap vert, franchit le Cap Horn, s’arrête à Valparaiso au Chili pour accoster enfin à Islay au Pérou. De là, elle franchit le désert à cheval pour arriver enfin dans la cité d’Arequipa. La cité compte à l’époque environ 30.000 habitants et est composée de “prés un quart de blancs, un quart de nègres ou métis, et moitié d’Indiens.” Grâce à la parenté de son puissant oncle et la réputation des “parisiennes”, Flora Tristan est partout ou presque accueillie par l’aristocratie locale toute puissante qui tient les rênes de cette jeune et fantoche République péruvienne.
Chaque étape de son périple est l’occasion de savoureux portraits des personnalités qu’elle rencontre, pointant sans relâche leur médiocrité, leur compromission, leur cruauté parfois aussi. Les militaires, les religieux, les politiciens sont les premières victimes de ces descriptions acides. Il faut lire le portrait de Don José Sébastian de Goyenèche, évêque avare et corrompu volant aux pauvres leur aumône. Celui de ces généraux aussi lâches, arrivistes qu’incompétents, qu’elle dépeint lors de la prise d’Arequipa dont elle fut témoin. La charge est féroce et Flora Tristan ne prit même pas la peine de changer les patronymes de ces modèles, ce qui lui vaudra de compréhensibles inimités.
Son oncle Don Pio de Tristan bien sûr n’est pas épargné. Aussi riche que pingre, il lui offre toute son affection mais lui refuse l’héritage paternel qu’il s’est accaparé, ne lui concédant que le gite et le couvert. Certains hommes ont cependant la sympathie sinon l’amour de Flora Tristan, qui dissimule à tous sa condition de femme mariée qui jetterait sur elle un opprobre indélébile. On pense à son cousin Althaus, au militaire Escudero, et surtout à Chabrié, le capitaine du navire qui l’a prend sous sa protection durant la traversée et lui propose de l’épouser. Flora Tristan, refuse cependant à contrecœur cette proposition bien entendu impossible, étant déjà mariée et privée par la loi de la possibilité de divorcer.
La narratrice dresse également un panorama de la vie locale, souvent d’après “les opinions et les usages de [sa] patrie“, comme elle le reconnait elle même dans la préface. Cette future internationaliste est encore pétrie de préjugés et son jugement apparaît parfois sans nuance sinon péremptoire. Elle est cependant parfois aussi visionnaire. Elle visite les plantations de canne à sucre et dénonce avec la plus grande virulence l’esclavage encore en vigueur. Celle qui allait devenir une icône de la lutte ouvrière et du socialisme naissant, précédant même Marx dans son appel à l’union des travailleurs du monde entier, se rit de l’avarice des Crésus et s’insurge contre l’accaparation des richesses par les propriétaires terriens.
Mais c’est sans doute son combat “féministe” (le mot n’existe pas encore) qui la distingue le plus de ses contemporains. Suivant les traces de la révolutionnaire Olympe de Gouges, elle montre combien la femme pourtant “bien supérieure aux hommes” selon ses mots, est méprisée, bafouée, violentée. Ses plus beaux portraits leurs sont réservées, qu’elles soient puissantes ou victimes..
Flora Tristan nous parle de sa cousine Carmen “d’une laideur qui [allait] jusqu’à la difformité“, qui eut à subir des années durant sans pouvoir se plaindre toutes les tortures imaginables de la part de son mari et qui malgré tout le soigna comme la plus aimante des épouses pendant sa longue agonie. Elle nous fait pénétrer dans les couvents d’Arequipa, qui loin d’être des havres de sainteté, se révèlent être des lieux de péché et de luxe, de fanatisme et d’oppression où derrière l’apparente égalité de la soutane “règnent, dans toute leur puissance, les hiérarchies de la naissance, des titres, des couleurs de la peau et des fortunes”. Elle évoque sa rencontre avec l’intrépide et impitoyable Doña Pancha, l’épouse du Président Gamarra, au moment où elle est déchue de son pouvoir.
Flora Tristan conte avec envie les femmes de Lima vêtues de saya, voilées des pieds à la tête et qui peuvent nous dit Flora Tristan, circuler incognito- et donc aimer ! – en toute liberté. Flora Tristan nous parle de cette “indomptable négresse” condamnée à mort pour avoir fait mourir son enfant en le privant d’allaitement et dont le regard disait “J’ai laissé mourir mon enfant, parce que je savais qu’il ne serait pas libre comme toi ; je l’ai préféré mort qu’esclave. » Elle nous présente les ravanas, ces femmes indiennes qui font office de cantinière et bravent mille dangers pour nourrir, vêtir, laver et loger les soldats, les surpassant en courage.
Mais le plus beau portrait de femme des Pérégrinations, c’est bien sûr celui de Flora Tristan elle-même : catholique fervente bousculant les valeurs chrétiennes ; intellectuelle sans instruction ; socialiste aimant le luxe ; aspirant aux honneurs mais vent debout contre l’ordre social. Bref, une femme pleine de fougue et de contradictions, moins sympathique que fascinante: un véritable personnage de roman. Son compatriote d’Arequipa, le grand écrivain Mario Vargas Llosa ne s’y trompera pas puisqu’il lui consacrera un de ses livres (Le Paradis un peu plus loin). Cette quête du paradis terrestre, Flora Tristan bien sûr ne l’atteignit jamais. Mais elle en paya le prix: en représailles à la parution du livre, son oncle lui supprima la petite pension qu’il lui avait consenti ; son mari abusa par vengeance d’une de ses filles (sans être condamné pour cela), puis tenta de l’assassiner en lui perforant le poumon gauche d’un coup de pistolet. Ses pérégrinations prient fin quelques années plus tard, alors qu’elle parcourait sans relache la France pour fédérer les Femmes et les ouvriers dans son grand projet d’Union Ouvrière. Elle mourut d’une fièvre typhoïde .
Extrait de Pérégrinations d’une Paria:
“Les ravanas sont les vivandières de l’Amérique du sud. Au Pérou, chaque soldat emmène avec lui autant de femmes qu’il veut ; il y en a qui en ont jusqu’à quatre. Elles forment une troupe considérable, précèdent l’armée de plusieurs heures pour avoir le temps de lui procurer des vivres, de les faire cuire et de tout préparer au gîte qu’elle doit occuper. Le départ de l’avant-garde femelle fait de suite juger de tout ce que ces malheureuses ont à souffrir, de la vie de dangers et de fatigues qu’elles mènent. Les ravanas sont armées ; elles chargent sur des mules les marmites, les tentes, tout le bagage enfin ; elles traînent à leur suite une multitude d’enfants de tout âge, font partir leurs mules au grand trot, les suivent en courant, gravissent ainsi les hautes montagnes couvertes de neige, traversent les fleuves à la nage, portant un et quelquefois deux enfants sur leur dos. Lorsqu’elles arrivent au lieu qu’on leur a assigné, elles s’occupent d’abord de choisir le meilleur emplacement pour camper ; ensuite elles déchargent les mules, dressent des tentes, allaitent et couchent les enfants, allument des feux et mettent la cuisine en train. Si elles se trouvent peu éloignées d’un endroit habité, elles s’y portent en détachement pour y faire la provision ; se jettent sur le village comme des bêtes affamées et demandent aux habitants des vivres pour l’armée ; quand on leur en donne de bonne volonté, elles ne font aucun mal ; mais, si on leur résiste, elles se battent comme des lionnes, et, par leur féroce courage, triomphent toujours de la résistance ; elles pillent alors, saccagent le village, emportent le butin au camp et le partagent entre elles.
Ces femmes, qui pourvoient à tous les besoins du soldat, qui lavent et raccommodent ses vêtements, ne reçoivent aucune paie et n’ont pour salaire que la faculté de voler impunément ; elles sont de race indienne, en parlent la langue et ne savent pas un mot d’espagnol. Les ravanas ne sont pas mariées, elles n’appartiennent à personne et sont à qui veut d’elles. Ce sont des créatures en dehors de tout ; elles vivent avec les soldats, mangent avec eux, s’arrêtent où ils séjournent, sont exposées aux mêmes dangers et endurent de bien plus grandes fatigues. Quand l’armée est en marche, c’est presque toujours du courage, de l’intrépidité de ces femmes qui la précèdent de quatre à cinq heures que dépend sa subsistance. Lorsqu’on songe qu’en menant cette vie de peines et de périls elles ont encore les devoirs de la maternité à remplir, on s’étonne qu’aucune y puisse résister. Il est digne de remarque que, tandis que l’Indien préfère se tuer que d’être soldat, les femmes indiennes embrassent cette vie volontairement et en supportent les fatigues, en affrontent les dangers avec un courage dont sont incapables les hommes de leur race. Je ne crois pas qu’on puisse citer une preuve plus frappante de la supériorité de la femme, dans l’enfance des peuples ; n’en serait-il pas de même aussi chez ceux plus avancés en civilisation, si une éducation semblable était donnée aux deux sexes ? Il faut espérer que le temps viendra où l’expérience en sera tentée.”
Pérégrinations d’une paria, Flora Tristan, réédition acte Sud (Babel) de 2004.