
Arequipa était au XIXème siècle une ville qui regorgeait de couvents. Celui de Santa Catalina, qu’on peut visiter aujourd’hui, est le vestige de cette époque. En 1833, l’écrivaine féministe Floria Tristan s’y réfugia quelques jours alors que des troubles agitaient la ville. C’est à cette occasion qu’une cousine de la célèbre femme de lettres franco-péruvienne, lui conta, ainsi qu’à trois nonnes de Santa Catalina, l’édifiante histoire Dominga, la nonne qui parvint à s’échapper du sinistre couvent de Santa Rosa. Floria Tristan a admirablement retranscrit ce récit dans son célèbre ouvrage Pérégrinations d’une paria paru en 1838.
Extrait de Pérégrinations d’une paria de Flora Tristan.
“Dès le lendemain de notre arrivée, chacune des trois amies avait laissé voir, en causant, un vif désir d’entendre de nous le récit exact de l’histoire de la pauvre Dominga ; le bruit courait dans le couvent que ces trois dames, depuis l’aventure de Dominga, en méditaient de concert, pour chacune d’elles, une non moins abominable. Rosita était de l’âge de Dominga et lui portait un vif intérêt, l’ayant beaucoup connue lorsque toutes deux n’étaient encore qu’enfants. Ma cousine Althaus, qui ne demandait pas mieux que de raconter cette histoire, pour la vingtième fois peut-être, s’offrit avec gaité à satisfaire la curiosité de ces dames. Il fut convenu que la bonne Manuelita engagerait ma cousine et moi à dîner en petit comité avec ses deux amies, afin de pouvoir causer tout à notre aise et aussi longtemps que nous le voudrions. Ce fut la veille de notre sortie du couvent que ce dîner eut lieu ; c’était terminer d’une manière assez piquante les six agréables journées que nous avions passées dans ce monastère.
Manuelita nous reçut dans sa jolie petite habitation du vieux couvent. Le dîner fut un des plus splendides et surtout des mieux servis de tous ceux où je fus invitée pendant mon séjour à Aréquipa. Nous eûmes de la belle porcelaine de Sèvres, du linge damassé, une argenterie élégante, et, au dessert, des couteaux en vermeil. Quand le repas fut terminé, la gracieuse Manuelita nous engagea à passer dans son retiro. Elle ferma la porte de son jardin et donna des ordres à sa première négresse, pour que nous ne fussions point dérangées, sous quelque prétexte que ce fût.
Ce petit retiro n’était pas aussi joli que celui de la supérieure, mais il était plus original. Comme j’étais étrangère, ces dames m’en firent les honneurs. On voulut que je prisse le divan à moi toute seule, et je m’y couchai mollement, appuyée sur des coussins de soie. Les trois religieuses, tout à fait élégantes avec leur robe à larges plis, prirent place autour de moi ; Rosita, assise sur un carreau, les jambes croisées à la mode du pays, se penchait sur le pied du divan ; la bonne Manuelita, assise à côté de moi, jouait avec mes cheveux, qu’elle dénattait et renattait de mille manières ; et la grave Margarita, au milieu de nous, montrait avec complaisance sa belle main grasse et blanche qui courait sur son gros rosaire d’ébène. Ma cousine, l’actrice principale, était assise, en face de son auditoire, sur un grand fauteuil bien à l’antique et avec un bon carreau sous ses pieds.
Ma cousine commença par nous faire connaître les motifs qui avaient déterminé Dominga à se faire religieuse. Dominga était plus belle qu’aucune de ses trois sœurs : à quatorze ans, sa beauté était déjà assez développée pour qu’elle inspirât de l’amour. Elle plut à un jeune médecin espagnol qui, apprenant qu’elle était riche, chercha à s’en faire aimer : ce lui fut chose facile ; Dominga naissait au monde ; elle était tendre et elle l’aima comme on aime à son âge, avec sincérité et sans défiance, croyant, dans sa naïveté, la pauvre enfant, que l’amour qu’elle inspirait égalait celui qu’elle éprouvait elle-même. L’Espagnol la demanda en mariage : la mère accueillit sa demande ; mais, craignant que sa fille ne fut trop jeune encore, elle voulut que le mariage ne se fit que dans un an. Cet Espagnol, comme presque tous les Européens qui abordent dans ces contrées était dominé par la cupidité ; il voulait arriver à de grandes richesses, et la possession de Dominga lui ayant paru un moyen d’y parvenir, il avait spéculé sur la crédule innocence d’une enfant. Il s’était à peine écoulé quelques mois, depuis que cet étranger avait demandé sa main, que, pour une femme veuve, sans nulle qualité, mais beaucoup plus riche que Dominga, il renonça à l’amour vrai de cette enfant, sans montrer le plus léger souci du profond chagrin qu’il allait lui causer en l’abandonnant. Le manque de foi de l’Espagnol blessa cruellement le cœur de Dominga : son mariage projeté avait été annoncé publiquement à toute sa famille, et sa fierté ne put supporter cet outrage. Cette jeune fille se sentait humiliée, et les consolations qu’on cherchait à lui donner ne faisaient qu’irriter une douleur qui aurait voulu se cacher à elle-même. Dans son désespoir, elle ne vit d’autre refuge que dans la vie conventuelle ; elle déclara à sa famille que Dieu l’appelait à lui, et qu’elle était résolue à entrer dans un monastère. Tous les parents de Dominga unirent leurs efforts pour ébranler sa résolution ; mais elle avait la tête exaltée, et les souffrances de son cœur ne lui permirent d’écouter aucune prière. Tout fut inutilement tenté : la jeune fille se montra aussi indifférente aux remontrances et aux conseils qu’elle avait été sourde aux sollicitations. La résistance qu’elle rencontra dans sa famille n’eut d’autre résultat que de porter son opiniâtre témérité à vouloir entrer dans le couvent le plus rigide de l’ordre des carmélites. Après un an de noviciat, Dominga prit le voile à Santa-Rosa.
Il parait, continua ma cousine, que Dominga, dans la ferveur de son zèle, fut heureuse les deux premières années de son séjour à Santa-Rosa. Au bout de ce temps, elle commença à se fatiguer de la sévérité de la règle. Les souffrances physiques avaient calmé l’exaltation morale, et de tardives réflexions lui firent verser des larmes sur le sort qu’elle s’était fait. Elle n’osa parler de son chagrin et de son ennui à sa famille, qui s’était si fortement opposée au parti qu’elle avait pris, et d’ailleurs à quoi cela aurait-il pu lui servir ? — Vous le savez, mesdames, ajouta ma cousine, tout regret est inutile : une fois entré dans une de vos retraites, on n’en sort plus.
Ici les trois religieuses se regardèrent, et il y eut un accord dans ces regards échangés à la dérobée, qui n’échappa à aucune de nous deux.
La malheureuse Dominga renferma ses chagrins dans son cœur, et, n’espérant de soulagement de personne, elle se résigna à souffrir, attendant de la mort la fin de ses maux. Chaque jour passé dans le couvent, que la religieuse ne considérait plus que comme sa prison, affaiblissait sa santé jadis si brillante ; une pâleur mortelle avait remplacé sur ses joues le vermillon qui donnait tant d’éclat à sa beauté, lorsqu’elle vivait dans le monde. Ses beaux yeux, devenus ternes, étaient enfoncés dans leurs orbites, comme ceux des pénitents épuisés par les austérités du cloître. Un jour, vers la fin de la troisième année, le tour de faire la lecture dans le réfectoire étant venu à lui échoir, Dominga trouva, dans un passage de sainte Thérèse, l’espoir de sa délivrance. Il est raconté dans ce passage que fréquemment le démon a recours à mille moyens ingénieux pour tenter les nonnes. La sainte rapporte, en exemple, l’histoire d’une religieuse de Salamanque, qui succomba à la tentation de s’évader du couvent, et à qui le démon avait suggéré la pensée de mettre, dans le lit de sa cellule, le cadavre d’une femme morte, destiné à faire croire, à toute la communauté, que la religieuse avait cessé de vivre, afin qu’elle eût le temps, aidée d’un messager du diable, sous la forme d’un beau jeune homme, de se mettre à couvert des alguazils de la sainte inquisition.
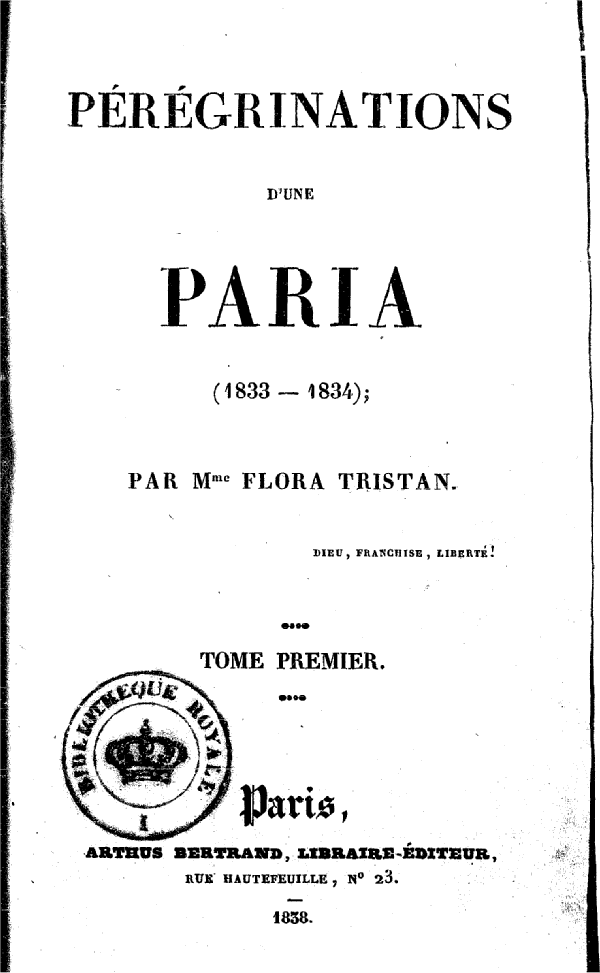
Quel trait de lumière pour la jeune fille ! Elle aussi pourra sortir de sa prison, de son tombeau, par le même moyen que la religieuse de Salamanque. Dès ce moment, l’espérance rentre dans son âme, et, dès lors, plus d’ennui : à peine a-t-elle assez de temps pour employer toute l’activité de son imagination à songer aux moyens de réaliser son projet. Plus de pratiques austères, de devoirs pénibles qui lui coûtent à remplir, parce quelle voit un terme à sa captivité. Elle changea graduellement de manière d’être avec les religieuses, recherchant les occasions de leur parler, afin de parvenir à connaître à fond chacune d’elles. Dominga tâchait surtout de se lier avec les sœurs portières. Les fonctions de ces sœurs ne durent que deux ans au couvent de Santa-Rosa. A chaque changement, elle s’efforçait, par ses attentions et ses assiduités, de se faire bien venir de la nouvelle portière. Elle se montra très généreuse et très bonne envers la négresse qui lui servait de commissionnaire au dehors du couvent, afin de s’assurer un dévouement sans bornes. La prudente et persévérante jeune fille n’oublia en somme rien de ce qui pouvait faciliter l’exécution de son projet. Huit années s’écoulèrent cependant avant qu’elle pût le réaliser, Hélas ! combien de fois, durant cette longue attente, la malheureuse ne passa-t-elle pas, de la joie délirante qu’éprouve le prisonnier près de quitter son cachot, par un effort de courage et d’adresse, au découragement profond, au désespoir de l’esclave qui, surpris au moment de sa fuite, va retomber sous la main d’un maître cruel ! Il serait trop long de vous raconter toutes ses anxiétés, toutes ses alternatives d’espoir et de crainte. Quelquefois, après avoir passé près de deux années à flatter une vieille sœur portière, dure et revêche, au moment où Dominga se croyait sûre de la sympathie et de la discrétion de la vieille, une circonstance lui faisait voir que, si elle avait eu l’imprudence de se confier à cette femme, elle eût été perdue. A cette pensée, Dominga, épouvantée du danger qu’elle venait de courir, frissonnait de terreur ; il se passait alors plusieurs mois sans qu’elle osât faire la moindre tentative. Il arrivait encore qu’au moment de se confier à une portière qui lui paraissait bonne et digne du terrible secret qu’elle avait à lui dire, celle-ci était changée et remplacée par une espèce de cerbère dont la voix seule glaçait la pauvre Dominga. C’est au milieu de ces cruelles anxiétés que vécut, pendant huit ans, la jeune religieuse. On ne conçoit pas comment sa santé put résister à une aussi longue agonie. A la fin, sentant qu’elle était au bout de ses forces, elle se décida et s’ouvrit à une de ses compagnes qu’elle aimait plus que les autres et qui venait d’être nommée portière. Sa confiance se trouva heureusement bien placée, et Dominga, assurée qu elle fut de l’aide et du silence de la portière, ne songea plus qu’aux moyens de se procurer ce dont elle avait besoin pour l’exécution de son projet. Il lui fallait se confier à la négresse, sa commissionnaire ; car, sans le concours de cette esclave, il était impossible de réussir. Cette confidence était entourée de dangers, et, dans cette circonstance, comme dans toutes celles qui se rattachent à l’exécution de son plan d’évasion, Dominga fut admirable de courage et de persévérance. Elle ne pouvait communiquer avec sa négresse qu’au parloir, et à travers une grille. Les paroles de Dominga pouvaient être entendues par une des silencieuses religieuses qui allaient et venaient sans cesse au parloir, et qui, sans cesse aussi, avaient l’oreille au guet. Voici le plan qu’avait conçu Dominga et qu’elle eut la hardiesse d’exposer à sa négresse, en lui offrant une large récompense pour dédommager cette esclave des périls qu’elle avait à courir.
Il fallait que la négresse se procurât une femme morte ; qu’elle l’apportât, le soir, à la nuit tombante, au couvent : la portière devait lui ouvrir et lui montrer l’endroit où elle cacherait le cadavre : ensuite Dominga devait, dans la nuit, le venir chercher, le porter sur son lit, y mettre le feu, puis s’échapper pendant que les flammes brûleraient le cadavre et le tombeau. Ce ne fut que très longtemps après être entrée dans l’entreprise de sa maîtresse que la négresse put apporter le cadavre. Il eût été dangereux d’en demander à l’hôpital qui, au surplus, n’en eût donné qu’à des chirurgiens, et pour un usage indiqué, attendu qu’il n’y a pas d’école de médecine à Aréquipa. Il était presque impossible d’obtenir le corps d’une femme morte chez elle : aussi assure-t-on que, sans les bons offices d’un jeune chirurgien qui fut mis dans la confidence, la bonne amie de Dominga aurait achevé ses deux années de sœur portière avant que l’esclave eût pu se procurer le cadavre qui devait, dans le couvent, faire croire à la mort de sa maîtresse. Par une nuit sombre, la négresse surmonta ses terreurs en songeant à la récompense promise, et chargea, sur ses épaules, le cadavre d’une femme indienne, morte depuis trois jours. Arrivée à la porte du couvent, elle fit le signal convenu ; la portière, toute tremblante, ouvrit, et la négresse, en silence, déposa son fardeau dans le lieu que, du doigt, lui montrait la portière. L’esclave alla ensuite se poster au détour de la rue de Santa-Rosa, pour y attendre sa maîtresse.
Dominga était, depuis plusieurs jours, en proie aux plus vives inquiétudes par les obstacles sans cesse renaissants qui entravaient l’exécution de son projet. Elle attendait, dans une anxiété inimaginable, le résultat des dernières démarches qu’on avait du tenter pour se procurer un cadavre de femme, lorsque son amie portière vint la prévenir que sa négresse en avait introduit un dans le couvent. À cette nouvelle, Dominga tomba à genoux, baisa la terre, puis, portant les yeux sur son Christ, resta longtemps dans cette position, comme abîmée dans un sentiment ineffable d’amour et de reconnaissance.
Le soir, la portière verrouilla la porte sans la fermer à la clef ; ensuite elle alla, selon que la règle l’exigeait, porter la clef à la supérieure et se retira dans son tombeau. Dominga, vers minuit, lorsqu’elle jugea que toutes Les religieuses étaient profondément endormies, sortit de son tombeau, où elle laissa sa petite lanterne sourde, et alla, à l’endroit que lui avait indiqué la portière, prendre le cadavre. C’était une charge bien lourde pour les membres délicats de la jeune religieuse ; mais que ne peut l’amour de la liberté ? Dominga enleva l’horrible fardeau avec autant de facilité que si c’eût été une corbeille de fleurs. Elle le déposa sur son lit, le revêtit de ses habits de religieuse, et, s’étant revêtue elle-même d’un habillement complet dont elle avait pris le soin de se pourvoir, elle mit le feu à son lit et prit la fuite, laissant grande ouverte la porte du couvent.
Ma cousine se tut, et les trois religieuses de Santa-Cathalina se regardèrent encore cette fois avec un air d’intelligence qui me fit pressentir leurs pensées. Après quelques instants de silence, la sœur Margarita demanda ce qui s’était passé au couvent, par suite de l’évasion de Dominga, et ce qu’on en avait pensé. — Personne, reprit ma cousine, ne se douta de la vérité. La sœur portière, qui ne dormait pas, comme vous devez bien le présumer, courut sur les pas de Dominga fermer sa porte au verrou ; et, dans la confusion occasionnée par l’incendie du tombeau, l’adroite portière sut reprendre sa clef chez la supérieure et ferma sa porte comme de coutume. Tout le monde fut convaincu que Dominga s’était brûlée. Les restes du cadavre que l’on trouva étaient méconnaissables, et ils furent enterrés avec les cérémonies en usage pour l’enterrement des religieuses. Deux mois après, la vérité sur cet événement commença à se répandre ; mais les religieuses de Santa-Rosa ne voulurent pas y ajouter foi ; et quand l’existence de Dominga avait cessé d’être un doute pour tout le monde, les bonnes sœurs soutenaient encore qu’elle était bien morte, et que ce qu’on racontait sur sa prétendue sortie du couvent était une calomnie. Elles ne furent convaincues que lorsque Dominga elle-même prit soin de les convaincre en attaquant la supérieure, pour qu’elle eût à lui restituer sa dot, qui était de 10,000 piastres (50,000 francs).
Pendant tout le temps qu’avait duré le récit de ma cousine, je m’étais occupée attentivement à remarquer l’effet produit par sa narration sur les trois charmantes religieuses. La plus ancienne des trois, la sœur Margarita, s’était à peu près constamment tenue dans sa réserve conventuelle. Il était échappé à la vive et impétueuse Rosita plusieurs exclamations qui dénotaient avec quelle sincérité cette aimable fille compatissait aux souffrances qu’avait éprouvées Dominga pendant ses onze années d’agonie. Quant à la douce Manuelita, elle pleurait et répétait souvent avec une naïve compassion : « Pauvre Dominga ! comme elle a dû souffrir ; mais aussi comme elle est heureuse d’être enfin délivrée ! » Et la gracieuse fille jetait sa tête sur mon épaule avec un mouvement d’enfant, et pleurait.
Nous nous retirâmes, laissant ces dames plongées dans une rêverie que nous ne crûmes pas discret de troubler. Je gagerais bien, dis-je alors à ma cousine, qu’avant deux ans ces trois religieuses ne seront plus ici. — Je le pense comme vous, me répondit-elle, et j’en serais bien contente : ces trois femmes sont trop belles et trop aimables pour vivre dans un couvent.”